Logique de la ségrégation
Je commencerai par adresser mes remerciements aux responsables d’Analyse Freudienne pour cette première invitation à travailler avec vous, en particulier à Robert Lévy qui en a pris l’initiative.
La violence fait partie des composantes anthropologiques de notre humanité. Que l’humain soit un parlêtre, qu’il soit ainsi doté de la parole qui lui donne la possibilité de dire la violence et d’éviter de l’agir, n’empêche en rien, depuis toujours, que l’homme soit un loup pour l’homme, qu’il se débatte avec ses pulsions destructrices et meurtrières, qu’il ait à les canaliser pour se structurer, pour faire lien social et acte de civilisation. Nous constatons que la question de la violence devient plus familière, plus ostensible dans un monde numérisé où la diffusion des informations obéit à un principe d’immédiateté, à une propension à la mettre en images, à l’afficher. Ce n’est pas sans retentissement sur notre manière de l’appréhender.
J’ai proposé cet intitulé très large. Il traduit mon état d’esprit à l’endroit de l’abord psychanalytique des questions que soulèvent les diverses formes de violence (auto ou hétéro-agressives, subies ou infligées). La violence est certes appréhendable sur le plan sociologique, mais ne peut être interprétée sur le plan clinique qu’au cas par cas, prenant une valeur symptomatique singulière suivant la structure clinique de la personne concernée, se traduisant par un passage à l’acte, un agir énigmatique ou une monstration inconsciente adressée à l’Autre (acting-out). Elle fait partie des modalités cliniques prégnantes auxquelles nous sommes de plus en plus confrontés et nous interroge sur ce qui la détermine. Est-elle un effet des mutations sociales contemporaines sur les subjectivités individuelles et en quoi ?
Dans la pratique clinique avec l’enfant ou l’adolescent, la symptomatologie liée à la violence nous impose de prendre la mesure des incidences délétères de son environnement familial et social. Sur ce dernier point, comment ne pas mentionner, à partir de mon expérience en institution, ces situations cliniques d’enfants ayant subi des violences qui se retrouvent placés, en foyer ou en famille d’accueil, et qui répètent les violences dont ils ont pâti ? Ils présentent une psychopathologie souvent complexe qui nécessite une concertation éclairée des professionnels de diverses institutions (aide sociale à l’enfance, pôle judiciaire, soignants, milieu scolaire), impliqués dans la prise en charge. Dans de telles occurrences, aucun praticien ne peut ignorer les écueils de la violence institutionnelle. Elle fait écho à celle dont ils sont porteurs depuis leur prime enfance. Si la violence institutionnelle n’a pas attendu le XXIème siècle pour émerger, certaines orientations des politiques publiques pourraient l’attiser.
Vous mettez en avant dans votre thème à l’étude cette année un « au-delà de la haine » et des « violences inédites ». Aussi, ai-je proposé à Robert de parler de mon élaboration sur la logique de la ségrégation. Elle me paraît capitale de nos jours et me semble pouvoir s’inscrire dans cette perspective de l’inédit. Quoique, à y regarder de plus près, cette ségrégation ne date pas que de ces dernières années. Lacan ne s’y était pas trompé. Il l’indiquait dès 1967, dans son « Allocution sur les psychoses de l’enfant », annonçant son émergence et son hégémonie à venir en raison des avancées des sciences. Je le cite : « (ce) facteur […] est le problème le plus brûlant à notre époque, en tant que la première, elle a à ressentir la remise en question de toutes les structures sociales par le progrès de la science. Ce à quoi, pas seulement dans notre domaine à nous psychiatres, mais aussi loin que s’étendra notre univers, nous allons avoir affaire, et toujours de façon plus pressante : à la ségrégation ».
J’ai travaillé cette question de la ségrégation dans mon premier ouvrage paru en 2011, Banlieues, Pointe avancée de la clinique contemporaine. Je me suis référé aux travaux de Freud et de Lacan en ayant à l’esprit que toute psychologie individuelle relève d’une psychologie collective, puisque nous sommes faits de l’Autre, assujettis aux discours sociaux, ces structures langagières sur lesquelles la parole se greffe. J’ai soutenu dans ce livre l’hypothèse selon laquelle la clinique rencontrée avec les patients, enfants, adolescents et adultes, habitants des banlieues de misère sociale, de ces véritables espaces de ségrégation sociale, est la « pointe avancée de la clinique contemporaine ». Pourquoi la « pointe avancée » ? Parce que cette clinique ne concerne pas que les subjectivités individuelles de ces citoyens, elle est diffuse à l’ensemble des populations du tissu social, notamment les jeunes générations, mais aussi à divers degrés toutes les générations. Elle relève de notre modernité dans une société occidentale, européenne, républicaine, laïque et démocratique, comme la nôtre. Or, le ségrégationnisme social est en pleine expansion. Il s’étend à toutes les classes sociales, à tous les territoires de notre espace social, y compris ceux qui regroupent des « ghettos » de populations aisées. La clinique contemporaine dont je parle n’est donc ni une clinique sociologique, ni une clinique discriminante des populations vivant dans des territoires ou quartiers défavorisés. J’ai tenté d’en repérer les spécificités et de la lire au regard de la logique actuelle de la ségrégation. Le discrédit de la parole en est la caractéristique fondamentale. Il me semble en grande partie responsable des manifestations symptomatiques de la violence de notre temps, chaque clinicien pouvant faire le constat d’une tendance croissante aux mises en acte, là où la parole et le pacte de paroles sont mis en défaut, au point de ne plus faire acte.
Je commencerai par préciser la notion de ségrégation, ce qui la différencie de l’exclusion. Cette distinction est le fruit de mon expérience professionnelle, surtout en institution, auprès de sujets dits « sans domicile fixe » et de jeunes habitants des « cités ». Je parlerai ensuite du « discours du capitaliste » : en quoi il génère une logique de la ségrégation, mais aussi son retentissement sur les subjectivités individuelles, en particulier ses effets de recouvrement imaginaire de la division subjective, la violence faite à la parole et les mises en acte qui en résultent. Enfin, j’évoquerai les deux versants de la psychologie de masse de la ségrégation : celui de la « psychose sociale » et celui de la dérive perverse dont les « bandes urbaines » sont un des paradigmes.
Segregatio désigne la séparation en latin. Son caractère sans équivoque, radical, de mise à l’écart, d’isolement, différencie la ségrégation de l’exclusion. Contrairement à l’exclusion, c’est moins l’individu qui pâtit de la ségrégation qu’un collectif. La ségrégation introduit la dimension de mise au ban d’une collectivité qui n’adopte pas la norme sociale dominante et la reconnaissance qui en découle. Ce processus collectif recouvre deux versants : celui de la ségrégation « passive », au sens d’une connotation de victime pour un collectif de personnes évincé du corps social par discrimination sociale, politique, raciale ou religieuse ; celui de la ségrégation « active » de ségrégués se revendiquant eux-mêmes d’un idéal qui réfute la norme en vigueur, mais qui peut aussi relever d’une conviction délirante.
Il est intéressant de bien distinguer l’exclusion de la ségrégation. Elles ne relèvent pas des mêmes logiques, elles n’ont pas les mêmes effets, quand bien elles peuvent être liées, car il arrive que des personnes en situation collective de ségrégation basculent individuellement dans l’exclusion et inversement. L’exclusion est « l’action de tenir quelqu’un à l’écart, de le repousser ». Elle concerne avant tout l’individu. C’est un terme paradoxal aux relents d’oxymore qui conjoint un rejet à l’extérieur (excludere) et une tendance à maintenir dedans (claudere). L’exclu (« vagabond », « clochard », « mendiant », « sans domicile fixe », « sans abri ») n’est pas sans une certaine reconnaissance du social, même si peu importe sa singularité. Pourtant, dans la jungle de la rue, il n’y a pas de collectifs, pas de « bandes » d’exclus, car la solidarité est quasiment nulle pour qui est entièrement préoccupé par sa survie personnelle. L’intérêt de la logique de l’exclusion repose sur le fait de la rapprocher de celle de la castration qui opère sur le sujet de l’inconscient (celui de l’énonciation qui est représenté par un signifiant S1 pour un autre signifiant S2). Il ne se constitue comme sujet qu’à condition d’une perte, pour ainsi dire d’une exclusion, celle de l’objet a qui le singularise comme sujet (le divise, cause son désir et « vectorise » son fantasme). Lacan en a donné une écriture avec le discours du maître, celui de la structure de la parole. C’est cette exclusion qui donne la possibilité au sujet de se créer un lieu dans l’Autre : le lieu de son dire. Cette question du lieu du sujet est essentielle pour interpréter la psychopathologie de l’errance si caractéristique de ces personnes exclues car, faute de castration, faute d’inscription de ce lieu, elles sont condamnées à l’atopie, destin psychotique par excellence.
Pour aborder la logique de la ségrégation contemporaine, je me réfèrerai à Lacan qui a proposé en 1972, à Milan, une écriture de ce qu’il a nommé le « discours du capitaliste », soit le support du néo-libéralisme économique. Ce n’est pas un véritable discours : ni point de butée, ni dimensions de l’impossible et de l’impuissance, ni véritable disparité des places, mais plutôt circuit continu de production de toujours plus d’objets de consommation. Il donne au sujet contemporain l’illusion que du manque qui le constitue comme sujet divisé, il serait soulagé, dès lors qu’il pourrait toujours trouver sur le marché l’objet propre à boucher son manque et à assouvir sa jouissance. Il induit une mise en cause de la différenciation des places dans le discours du maître, celui qui équivaut à la structure de la parole, annulant ainsi l’Altérité, discréditant à la fois le savoir S2 qui normalement vient légitimer et tempérer le signifiant maître S1 et le S1. Par son caractère mondialisé, le discours du capitaliste accentue la méconnaissance des lois de la parole et du langage, réduisant le désir au besoin en faisant fi de la castration.
En quoi peut-on estimer que la forme contemporaine de la ségrégation est une conséquence du discours du capitaliste ? Qu’en est-il de sa logique structurale ? Ce sont les travaux de Marcel Czermak sur l’hypochondrie vraie de la psychose, en particulier le Cotard, sa forme extrême, qui m’ont mis sur la voie. Le discours du capitaliste est une machine infernale qui, cherchant à combler tout manque, pousse à la complétude. On peut ainsi établir une analogie logique entre la clinique individuelle du cotardisé – ce parlêtre atteint d’une insupportable plénitude qui le prive de tout manque et qui réclame à en être décomplété – et la ségrégation de masse – cette dernière induite par un pousse au consumérisme incessant jusqu’à ne plus manquer de rien, jusqu’à un effet de complétude qui en appelle à la décomplétude et qui va engendrer des fragmentations à l’infini du tissu social. Or, cette dynamique automatique de complétude/ décomplétude, a tendance à s’auto-perpétuer et à s’étendre. Il en est ainsi du séparatisme social actuel décrit par l’économiste Eric Maurin. C’est en cela que je parle de logique contemporaine de la ségrégation. Elle est à rapprocher de ce que Lacan avait nommé la « psychose sociale ». La démultiplication des fragmentations pourrait concrétiser le culte de l’hyper individualisme !
J’inscris la logique de la ségrégation contemporaine comme une des conséquences majeures de ce « discours » qui introduit un démenti (d’autres termes de négation ont été avancés : révocation, récusation, déni..) sur la structure du discours du maître, c’est-à-dire sur la structure de la parole, celle de l’énonciation du dire du sujet. Ce processus de subversion de la structure de la parole engendre la plus grande des violences sur la parole elle-même. Il a des effets sur le rapport à la castration et à la division subjective des névrosés. Cela ne veut pas dire que nous n’ayons plus affaire à des névrosés aux caractéristiques plus freudiennes. Je ne fais que constater de nouvelles dispositions subjectives dans le transfert dont une propension accrue aux mises en acte, y compris des violences, dès lors que le statut de la parole est mis en cause et n’aurait plus tout à fait le même poids. Sans compter l’impact du langage numérique qui contribue à survaloriser la communication en faisant comme abstraction de la dimension de la parole. On peut parler de perversion sociale promue par le discours du capitaliste sur les subjectivités individuelles des névrosés. Par ailleurs, je considère que le trépied structural freudien garde toute sa valeur, que la clinique des psychoses ne s’est guère modifiée, que c’est bien la perversion sociale qui domine le champ de la perversion, les perversions sexuelles stricto sensu demeurant identiques.
Quelles sont ces caractéristiques cliniques nouvelles qui se retrouvent surtout chez les jeunes générations, même si elle s’étend à toutes les générations et indépendamment de leur milieu social ?
En premier, le « discours du capitaliste » bouscule les subjectivités humaines au point de court-circuiter la disparité des places inhérentes à la structure de la parole. Il en résulte une plus grande confusion quant à la spécificité de chaque discours et une moindre fluidité de leur circularité, comme s’ils tendaient à s’indifférencier. La parole semble discréditée ayant plus de difficultés à s’insérer dans un discours qui puisse l’abriter et l’inscrire dans les lois du langage.
Il en découle ce que j’ai appelé la « pseudo-suture » de la division subjective, soit son recouvrement imaginaire par un effet de complétude, à force d’être baignés dans l’illusion et de s’entretenir dans cette illusion, qu’un objet de consommation pourrait se substituer à l’objet singulier du manque qui nous constitue. Nous avons plus souvent affaire à des patients qui donnent moins de crédit à leur propre parole. Ils ne sont pas dans la position subjective de subjectiver leurs propos, ne croyant plus vraiment à ce qu’ils avancent, ce qui se redouble d’une certaine impuissance à prendre en considération la parole du clinicien qui les accueille. Un flottement subjectif est à l’œuvre qui ne correspond ni à une rationalisation obsessionnelle ni à une inhibition, ni même à un émoussement dépressif. Il les déleste de leur responsabilité de sujet.
Troisième caractéristique : une incrédulité à l’endroit de l’Autre, y compris à ce qu’il puisse lui apporter de l’aide. Autrement dit, le discrédit s’étend au savoir dans l’Autre. Que tous les savoirs de connaissance, même s’ils ne relèvent pas du savoir troué propre à l’inconscient, soient désormais accessibles par le net en favorise l’essor. Cela rend d’autant plus relatif le crédit octroyé à l’inconscient, d’autant que l’époque est aux neurosciences, au cerveau sans parole, à la forclusion du sujet.
Le fait de ne pouvoir accréditer sa propre parole, ni d’adhérer à la parole de l’Autre se traduit par une symptomatologie moins spécifiée. Cela implique que le névrosé de la clinique contemporaine a encore plus de mal à appréhender son symptôme, à le subjectiver, à le mettre au travail de ses signifiants. Les symptômes sont moins caractérisés et ne sont susceptibles de se différencier qu’à la faveur d’un transfert, quand il est possible. Cela a des incidences sur l’implication du clinicien dans le maniement du transfert.
Dernière caractéristique : celui des mises en acte qui prennent le pas sur la parole dans un monde de l’immédiateté et de la profusion d’objets à se mettre sous la main. C’est à ce niveau que la violence prend de l’ampleur sous le versant devenu ordinaire des toxicophilies et des toxicomanies : recours accru à toutes sortes de drogues à partage en miroir avec l’autre, compulsion à se procurer le produit, l’objet adéquat pour vivre et surtout survivre jusqu’à devenir toujours plus l’esclave de sa jouissance inconsciente. Il est clair que dans les territoires de misère sociale, c’est un mirage qui fait florès, car le consumérisme est perçu comme un droit à l’égalité pour tous, une réparation de l’injustice sociale. Il en va aussi chez les adolescents surtout des tentatives de suicide, des effractions sur le corps, des impératifs d’avoir à inscrire sur sa peau les marques d’une appartenance, à la recherche d’une identité, faute de trouver les mots…
A l’échelle de la psychologie des masses, je soutiendrai que la logique contemporaine de la ségrégation est symptomatique de notre malaise présent dans la Kultur et inductrice des faits de violence actuels. Deux axes en sont repérables : celui d’une dérive perverse et celui d’une psychose « collective ». Pour cette dernière, je ferai remarquer que la ségrégation en tant que processus collectif conjoint deux versants de l’identification. D’une part, celui de l’identification imaginaire, spéculaire, modalité qui repose sur une identification croisée aux semblables, dans l’horizontalité des relations entre alter ego d’une même confrérie qui participe d’un rassemblement, d’une massification. Ce versant vaut pour les deux axes cités. D’autre part, celui d’une identification à un trait réel – trait qui n’a pas la valeur symbolique du trait de l’idéal du moi du meneur de foules, pas celle du trait unaire – qui met en échec l’identification symbolique dans sa fonction et son efficace. Une telle défection symbolique traduit la mise à mal de la fonction paternelle. Elle touche à son rejet, à sa forclusion. Elle correspond à cette pente « psychotisante » de la ségrégation qui prend l’allure d’une paranoïa collective, centrée autour d’un trait réel réduit au signe, qui fait Un et certitude dans l’Autre. On peut alors parler d’unification plutôt que d’identification. Nous en avons des traductions sociales en pleine expansion : les engouements passionnels et fanatiques pour telle ou telle idéologie totalitaire, radicale (religieuse, politique, sectaire, terroriste) et, à moindre échelle, les dérives communautaristes vers des revendications identitaires (culte d’une identité Une), xénophobes. Toutes ces dynamiques drainent la haine de l’autre, de l’étranger, la haine de toute Altérité de sexe, de culture, de langue, de couleur de peau, de religion, de classe sociale …
Enfin, je ferai référence aux « bandes » en tant que paradigme de la dérive perverse de la ségrégation. J’évoquerai brièvement le cas d’un adolescent victime d’une agression physique (fracture du tibia) de la part de quelques autres, d’une autre bande, celle d’une cité voisine. Son cas m’a marqué par sa violence. Son histoire clinique singulière s’inscrit parmi celles de ces enfants nés en France de parents migrants, de milieu social défavorisé, pris dans les rets d’une double culture. Il est élevé dans une famille plutôt bienveillante, mais vraiment chaotique, désunie, dans laquelle il ne trouve pas les repères stables nécessaires à son éducation et à sa maturation. A l’initiative de ses consultations, sa mère insistait moins sur ses difficultés scolaires que sur son comportement transgressif au collège et ses « fréquentations ». Il était passif, hostile à consulter un « psy ». Il m’a beaucoup questionné par son peu d’aptitudes à mettre des mots sur ses difficultés, à les reconnaître comme étant siennes. Il présentait ce flottement subjectif que j’ai évoqué, ne donnant apparemment pas de crédit à sa propre parole et à peine à la mienne. Familier, sans agressivité manifeste, il ne me traitait pas non plus en alter ego. C’est un patient qui a nécessité de ma part un engagement de parole pour qu’il puisse au minimum s’inscrire dans la relation. Il n’était pas vraiment dans le discrédit du savoir dans l’autre, mais il ne semblait ne rien attendre de ses consultations imposées par sa mère qu’il écoutait. Il faisait partie de ces adolescents, susceptibles d’emboîter le pas à des faits de petite délinquance, non pas meneurs, mais plutôt sous la protection et le contrôle de la bande de sa cité d’habitation. Il avait transgressé quelques fois, mais sans me le dire. Je ne l’ai su que dans l’après-coup. Son père ne s’occupait pas du tout de lui, ayant démissionné à son endroit. Seules sa mère et ses sœurs veillaient au grain, mais de façon intermittente. Il était livré à lui-même dans un environnement familial précaire. Son errance subjective était en grande partie liée à des carences éducatives. Après un temps de suivi, il a été victime de cette agression. Une fois l’effroi passé, l’angoisse d’une récidive mise à distance, nous avons pu nouer des liens transférentiels plus resserrés, ayant moi-même répondu présent en ces moments difficiles. Ce passage à tabac a probablement contribué à l’éloigner de sa bande, le remettant à son travail scolaire. Je ne l’ai pas revu depuis un an mais il a passé un CAP et s’oriente désormais dans la vente de produits ordianaires de consommation, de ceux qui l’ont conduit autrefois à des petits trafics…
Cette dimension de dérive délinquante est nettement repérable dans les territoires de ségrégation sociale avec des « jeunes des cités » qui rejettent d’autant plus les normes de la société française qu’ils s’en sentent bannis, se sachant au bas de l’échelle sociale et économique. Les phénomènes de « bandes » ne sont pas un phénomène nouveau en France. Si les familles issues de l’immigration y sont surreprésentées, étant majoritaires dans les « cités », les bandes ne sont pas pour autant « ethniques ». Elles réunissent des jeunes chômeurs sans qualification, des lycéens, des collégiens. Ce sont essentiellement des bandes de garçons, mais désormais les filles n’en sont le plus systématiquement écartées, quand elles ne se constituent pas à leur tour en bandes. Les filles, surtout dans les familles d’immigrés, restent très surveillées, à la fois convoitées par des garçons d’autres bandes et susceptibles de trahison, au regard du code d’honneur familial, ce qui peut conduire à des violences gravissimes. Il est remarquable que l’Altérité qui a trait à la différence des sexes ne soit pas vraiment remise en cause dans ces bandes et persiste. Ce n’est pas le mimétisme de certaines filles qui cherchent à faire comme les garçons et même mieux qu’eux qui vient le démentir. Enclins à des exactions, ces jeunes n’hésitent pas à traiter l’autre comme un objet, ce qui les condamne à être traités de la même façon.
L’individualisme masqué par l’appartenance à la bande y est à son comble. Les membres de la bande semblent fonctionner comme en dehors de la société, établissant leurs codes internes, leur langage commun et identitaire, le fameux « langage des cités », une hiérarchie malgré tout organisée autour d’un chef désigné qui a fait ses preuves de domination et de virilité. La force physique y est capitale et constitue un moyen de domination, d’exercice du pouvoir vis à vis d’autres bandes. Ces jeunes se révèlent souvent peu politisés, à la dérive, sans perspectives d’avenir, en échec dans leur scolarité, protestataires actifs, le plus souvent passifs. Sur fond de dérive perverse des conséquences de la ségrégation, certains glissements sont très inquiétants. Ainsi, les combats entre bandes rivales. Chacune devient le porte-drapeau de sa cité. Tout se passe comme si le toponyme de leur lieu de vie se réduit à un signe identitaire réel, pour ne pas dire un Un réel auquel ils viennent s’unifier pour protéger leur espace de vie.
De la dérive perverse à la paranoïa collective il pourrait y avoir des points de passage, un continuum qui pendrait forme. Je rejoins en ce sens l’analyse de certains collègues brésiliennes (A. Jesuino, A. Sosta) qui estiment que nous en arrivons à une ségrégation qui s’accentue, qui fragmente les masses et qui rend compte d’un délitement du signifiant et du politique, au point désormais d’avoir affaire, par le biais des réseaux numériques, à des foules sans leader, chacune s’agglutinant autour d’un signifiant réduit à un signe et qui s’impose comme un mot d’ordre impératif auquel chaque participant aurait à se soumettre. Je ne saurais en préjuger. Mais je n’oublie pas que le réseau social est aussi soumis à des intérêts, qu’il peut être source de manipulations au service de …Néanmoins, autant en prendre la mesure et réfléchir à ces formes inédites de violence qui ne sont pas sans déterminisme social, culturel, économique et politique.
A l’œuvre à l’échelle du collectif, la ségrégation fait des ravages sur les subjectivités individuelles et n’est pas sans induire toujours plus de violence. Cette logique peut être appréhendée par ses effets cliniques et lue sur le plan de la structure. Elle oblige les cliniciens, en particulier les psychanalystes, à en prendre la mesure, à réfléchir aux mutations en cours et à la place de la psychanalyse dans la cité, à leur responsabilité éthique, à leur responsabilité citoyenne à partir des enseignements qu’ils ont pu tirer de leur propre cure et de celles qu’ils mènent avec leurs patients.
Louis SCIARA
Psychiatre Psychanalyste à Paris
Auteur « Banlieues »
Pointe avancée de la clinique contemporaine
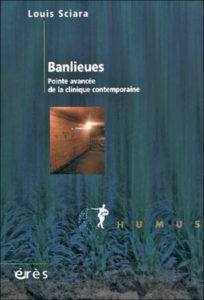
Cachez ces banlieues que nous ne saurions voir. Etranges, opaques, assommantes. Un sentiment de malaise, un nouvel unheimlich nous envahit lorsque nous pénétrons entre ses murs. Même si jusqu’à preuve du contraire la banlieue n’est pas encore l’équivalent du ghetto de Varsovie, les médias, les ouï-dire et les ouï-lire nous accompagnent. Et justement la psychanalyse dont on nous dit qu’elle n’intéresse plus personne ne disposerait-t-elle pas des outils les plus à même de dresser une carte de cette terra incognita ? C’est le pari de ce livre.
Aujourd’hui certains…[Lire la suite de la critique de Anne Djamdjian sur le site d’Œdipe.org]


 Follow
Follow